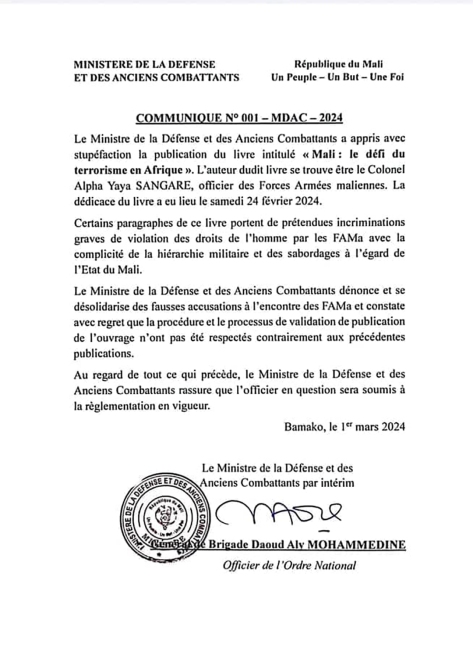
Archives du mot-clé Afrique
URGENT: le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent de la CEDEAO
Dans un communiqué conjoint diffusé le 28 janvier 2024, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé leur décision de quitter la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette annonce, faite simultanément à Bamako, Niamey et Ouagadougou, marque une rupture significative dans les relations régionales.
Le 28 janvier 2024, les Chefs d’État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger ont annoncé leur décision de se retirer de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette décision historique, prise conjointement par le Capitaine Ibrahim Traoré, le Colonel Assimi Goïta et le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, marque une rupture significative avec cette organisation panafricaine, fondée en 1975.
Le communiqué conjoint, émis depuis Ouagadougou, Bamako et Niamey, souligne un sentiment de déception et de trahison vis-à-vis de la CEDEAO, accusée de s’être écartée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Les dirigeants actuels du Burkina Faso, du Mali et du Niger expriment leur regret face à ce qu’ils considèrent comme une influence néfaste de puissances étrangères sur l’organisation, alléguant que la CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres.
Le communiqué critique également la réponse de la CEDEAO aux défis sécuritaires auxquels ces pays sont confrontés, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Les chefs d’État dénoncent les sanctions imposées par la CEDEAO, les qualifiant d’illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables, et accusent ces mesures de fragiliser davantage les populations déjà affectées par des années de violence.
La décision de se retirer de la CEDEAO est présentée comme une mesure souveraine, répondant aux attentes et aspirations des populations de ces trois pays. Ce retrait marque un tournant dans les relations régionales en Afrique de l’Ouest et pose des questions sur l’avenir de la coopération économique et politique dans la région.
CAN 2023 : les AiGLES du Mali volent plus haut que les BAFANA BAFANA d’Afrique du Sud (2-0)
Korhogo, Les Aigles du Mali ont réussi à s’imposer face aux Bafana bafana d’Afrique du Sud, mardi 16 janvier 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, lors de la première journée du groupe E, de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023.
Les Sud-africains se sont montrés plus percutants en première mi-temps, en dominant le match sur les plans tactique et technique jusqu’à obtenir un pénalty à la 18ème mn. Ils ont malheureusement laissé échapper une grosse occasion de mener au score, suite à un raté de Percy Pau.
 Le Mali était en difficulté durant toute la première période au grand désarroi d’un public quasiment acquis à sa cause, mais n’a pas encaissé de but jusqu’à la mi-temps (0-0).
Le Mali était en difficulté durant toute la première période au grand désarroi d’un public quasiment acquis à sa cause, mais n’a pas encaissé de but jusqu’à la mi-temps (0-0).
A la reprise, les hommes d’Éric Chelle, se sont montrés plus déterminés et prouvé leur envie de vaincre. Ils étaient présents à la fois physiquement, que techniquement. Ce qui a fini par payer à la 60ème mn grâce à l’ouverture du score d’Amari Traoré sur un coup de pied arrêté, mal négocié par le portier sud-africain Ronwen Williams.
Sept minutes plus tard, le Mali corse l’addition grâce à Lassina Sinayoko à la 67ème mn. Score final (2-0) en faveur du Mali
Les rencontres du mercredi 17 janvier 2024, Maroc-Tanzanie à 17h GMT et République démocratique du Congo (RDC)-Zambie à 20h GMT.
(Agence Ivoirienne de Presse) Krk/haa
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA CHINE EN TOURNEE EN AFRIQUE : le Mali a-t-il été relégué au second plan par Le pays de Mao ?
Conformément à une tradition établie depuis plus de 34 ans, le ministre des affaires étrangères de la chine effectue chaque année une tournée en Afrique pour marquer l’importance stratégique du continent pour la chine. Alors que le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali n’a raté aucune occasion pour affirmer Urbi et Orbi que la chine est l’un des partenaires privilégiés et fiables du Mali, son homologue de la chine, celui de l’empire du milieu a plutôt choisi l’Egypte, la Tunisie, le Togo et la Côte d’Ivoire pour sa traditionnelle tournée annuelle en Afrique. Le choix de ces pays ne prouve-t-il pas à suffisance que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali est encore dans l’émotion et dans le sentimentalisme et que le Mali est véritablement isolé ? La Chine et même la Russie sur lesquels les autorités maliennes fondent de l’espoir ne sont-elles pas dans la préservation de leurs intérêts économiques plutôt que dans un combat géopolitique ? Dans l’instabilité chronique dans laquelle se trouve le Mali pourrait-on compter sur la Chine ?
Cette tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique sans le Mali est un revers cinglant pour la diplomatie malienne qui a pourtant semblé faire croire que le Mali est une priorité pour les autorités chinoises et que la coopération sino malienne est vieille de plus de 60 ans. Comment un pays qui traverse une crise aussi profonde que gravissime comme le Mali et qui a comme partenaire privilégié la Chine, puisse être relégué au second plan par cette dernière qui vient s’arrêter à sa porte et chez « son ennemi juré qui est la Côte d’Ivoire » ? L’histoire est-elle en train de nous donner raison quand nous avions affirmé sans ambages que la diplomatie telle que menée par les autorités maliennes isole notre pays. En effet, le fait de se brouiller avec beaucoup de pays, à tort ou à raison, alors même que les intérêts sont liés, avec la mondialisation de l’économie, fait sans nul doute du Mali un pays isolé qui n’est pas une bonne destination pour les investisseurs.
Wang Yi, le patron de la diplomatie chinoise, a entamé le samedi 13 janvier 2024 et cela jusqu’au 18 du même mois, une tournée dans quatre pays africains pour raffermir les liens de coopération entre la chine et tous ces pays, mais aussi et surtout pour consolider les relations économiques avec eux. Il se rendra en Egypte, en Tunisie, au Togo et en Côte d’Ivoire. Pourquoi ces pays au détriment du Mali alors même que la Chine et la Russie sont les pays partenaires de premier choix des autorités actuelles ? La Chine a-t-elle beaucoup plus d’intérêts avec ces quatre pays qu’avec le Mali ? L’instabilité institutionnelle, voire l’insécurité au Mali en est-elle pour quelque chose ? L’affirmation selon laquelle l’argent n’aime pas le bruit de bottes pourrait justifier le choix de ces quatre pays au détriment du Mali, car depuis plus de 3 ans le Mali traverse une crise institutionnelle consécutive au coup d’Etat. En effet, la Chine entretient certes des relations diplomatiques avec le Mali, mais elle semble privilégiée ses intérêts économiques d‘où le choix de ces pays. C’est encore une fois de plus un signal fort à l’endroit des autorités pour qu’elles sortent le pays de l’isolationnisme et du statut quo ante pour retrouver la normalité constitutionnelle. Aucun pays ne sera prêt à coopérer véritablement avec le Mali tant qu’il se trouve dans une situation d’exception qu’est la transition. Aucun discours populiste ne doit convaincre le Président de la transition à rester dans cette posture en ayant comme seule arme la répression. En tout cas si certains responsables sont encore dans l’émotion et le sentimentalisme le monde est dans le réalisme, dont les intérêts seuls comptent.
Youssouf Sissoko
CAN 2023: Mohamed Camara, le milieu de terrain des Aigles du Mali sera-t-il de la partie ?
La participation de Mohamed CAMARA, le milieu de terrain des AIGLES du Mali est compromise. En effet, l’athlète malien traîne encore les séquelles d’une blessure qui lui impose de revoir le médecin.
34ème ÉDITION DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS : les Aigles pourront-ils se déplumer du poids mental ?
Pour le plus grand bonheur du public sportif africain, la CAN a débuté dans le pays de feu Félix Houphouët Boigny. Rarement, une coupe d’Afrique n’aura été si attendue et surtout si convoitée par les équipes qui compétiront pour décrocher le graal. Et pour cause, au vu des formations participantes, cette CAN sera difficile à gagner, quel que soit le pedigree de l’équipe. Quasiment toutes les équipes se valent, et il ne serait pas inopportun d’affirmer que le gagnant de cette coupe aura remporté plus qu’un simple trophée. Quid alors des Aigles du Mali pour lesquels l’on attend à chaque édition, qu’ils matérialisent tout le bien que l’on pense d’eux ?
Ça y est donc, les Africains vibreront au rythme de leur CAN. Sur le plan organisationnel, les autorités ivoiriennes auront mis le paquet. Des infrastructures remises à neuf, une ambiance festive comme savent si bien le faire les compatriotes du président Alassane Dramane Ouattara. Sur le plan sportif, le défi est, semble-t-il, plus ardu. Et ce, pour toutes les équipes présentes.
Les lions de la Teranga, tenants du titre, partent logiquement favoris, avec une ossature qui n’aura pas réellement varié depuis leur dernier sacre. Toutefois, il y a aussi d’autres lions, ceux de l’Atlas du Maroc. Les poulains du coach Walid Regragui, après une demi-finale historique pour une nation africaine à la dernière coupe du monde, auront à cœur de remporter cette coupe. Pour rappel, le Maroc, bien qu’étant considéré comme un grand du continent sur le plan du football, ne compte qu’une coupe d’Afrique dans son placard. Une anomalie que compte bien corriger les joueurs marocains.
Autre favori et non des moindres, c’est l’Algérie. Après une décevante prestation lors de la dernière CAN avec une élimination dès le premier tour, l’entraineur algérien, Djamel Belmadi, entend bien prouvé que son pays reste la valeur sûre du moment sur le continent. Car, rien de plus efficace qu’une nouvelle CAN pour panser les plaies d’une élimination dans les ultimes minutes pour un match qualificatif à une Coupe du monde.
En même temps, évoquer les favoris d’une CAN sans mentionner les pharaons d’Égypte, serait semblable à un crime de lèse-majesté. Il s’agit du finaliste malheureux de la dernière édition, du détenteur du record de nombre de trophées glanés, et a ce luxe de pouvoir s’appuyer sur un championnat professionnel, le plus relevé du continent. Dans une CAN, l’Égypte est forcément favorite.
Mis à part ce quatuor, une bonne partie des équipes se valent plus ou moins. La Côte d’Ivoire qui aura à cœur de remporter cette édition qu’elle organise, peut elle aussi remporter le trophée mais à une double condition. D’abord, qu’elle parvienne à ne pas se faire écraser par la pression populaire qui l’entoure et ensuite qu’elle arrive à construire une véritable équipe, soudée et avec du caractère.
Au-delà, nous aurons une Tunisie, toujours fidèle à elle-même avec une grande maturité tactique et un vice redoutable, une équipe du Nigéria avec son armada offensive, une Guinée toujours si talentueuse et enthousiaste dans le jeu, une Gambie teigneuse et ambitieuse à la fois, le Ghana avec un mélange de jeunesse et d’expérience et une Afrique du sud organisée avec un football se basant sur des incursions rapides sur les côtés.
Quid des Aigles du Mali ?
Il semblerait que cette fois, le sélectionneur malien ait pris la bonne mesure du défi qu’il a à relever. Même si, des détails peuvent faire croire que cette équipe malienne a encore des manques criards dans son jeu, notamment en défense, un bon discours au bon moment peut faire mouche auprès d’un groupe de joueurs avec certes un très bon potentiel, mais qui souffrirait du « syndrome du joueur malien ». Pour réussir une compétition, le talent ne suffit pas, loin de là. Il faut, tout naturellement de l’expérience, de la discipline, et un esprit d’équipe à toute épreuve. Lorsque l’on joue au football dans le haut niveau, il s’agit de s’acquitter de sa tâche avec sérieux, abnégation et , s’il le faut, avoir l’esprit que l’on se trouve dans des tranchées, et que l’adversaire peut frapper à tout moment. C’est cela qui aurait manqué à nombres de sélections maliennes, bien sûr en mettant de côté, tous les manquements au niveau politique et administratif qui impactent aussi de manière négative les résultats.
Le coach Éric Sékou Chelle a-t-il pu ou su trouver la bonne corde pour tirer ses poulains vers le haut ? Ce bon discours pourra-t-il pallier à un certain déficit de forme de plusieurs joueurs maliens ? Avec le premier match, nous aurons des éléments de réponses.
Ahmed M. Thiam
VŒUX DU NOUVEL AN : les partis politiques au Mali, ont-ils fait le deuil du retour à l’ordre constitutionnel en 2024 ?
Montée en puissance des Forces de défense et de Sécurité, réorganisation interne et mobilisation des militants, fin de la transition, nostalgie de la terre natal… Voilà, entre autres ce que notre rédaction a retenu des vœux des différents états-majors politiques au seuil du nouvel an. Mais, peu d’entre eux ont ouvertement abordé la question du retour à l’ordre constitutionnel initialement prévu en mars prochain avant le report de la présidentielle de février le 25 septembre dernier.
Comme le Bureau politique national de l’Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques (ASMA-CFP), la classe politique malienne a reconnu presqu’à l’unanimité que 2023 a été «une année très éprouvante» pour le Mali et les Maliens. Il est vrai qu’entre l’incapacité du gouvernement à maintenir les prix à la hauteur des sacrifices fiscaux consentis et la crise énergétique, les populations maliennes ont presque bu le calice jusqu’à la lie.
Mais, elles se sont montrées d’une surprenante résilience convaincue que c’est le prix à payer pour la gouvernance vertueuse souhaitée par tous. Le BPN de l’Asma Cfp a ainsi réaffirmé sa «solidarité à tous nos compatriotes dont le quotidien se résume, du fait des difficultés financières, à chercher à survivre». Pour le président de la Codem, Housseini Amion Guindo dit Poulô, l’année 2023 a été «marquée par un contexte sociopolitique et sécuritaire particulièrement difficile pour notre pays avec des attaques terroristes qui ont endeuillé des milliers de familles et fait des milliers de déplacés et de réfugiés…».
«Mon plus grand souhait est que 2024 soit l’aube d’une nouvelle ère pour le peuple malien ; l’ère de la paix totale sur tout notre territoire afin que nous puissions continuer à écrire les pages glorieuses de notre histoire dans un Mali indépendant et véritablement souverain», a souhaité Poulô. Et de rappeler que notre «devoir collectif en ce moment historique critique» est de nous «unir pour faire face aux défis actuels et assurer à la génération future la sécurité, la santé et le développement économique et social». Et surtout que, comme l’a rappelé le président Modibo Sidibé des FARE An Ka Wuli, «les défis restent nombreux et les enjeux complexes sur les plans économique, social et sanitaire, institutionnel, éducatif, environnemental ; particulièrement ceux relatifs à la jeunesse malienne, rurale comme urbaine».
Rebattre les cartes pour garder notre destin en main
«J’ai l’intime conviction que notre destin est entre nos mains et qu’il est à la dimension de nos ambitions nationales, régionales et africaines», a assuré l’ancien Premier ministre. Et pour ce faire, a-t-il conseillé, il nous faut «rebattre les cartes afin d’ouvrir de véritables opportunités aux générations montantes et de jeter les fondamentaux en matière institutionnelle, sécuritaire, infrastructurelle, économique, éducative, scientifique, technologique et d’innovation».
L’Adéma-Pasj a exhorté les autorités de la Transition et les Maliens, «au-delà des enjeux de la diversité d’opinion», à faire en sorte que 2024 soit une année de «cohésion sociale, de patriotisme, de résilience, de réconciliation des cœurs, d’unité et de concorde nationale». Elle a aussi appelé les dirigeants actuels du pays à privilégier «le dialogue avec la classe politique et l’ensemble des forces vives de la nation pour trouver un consensus national sur les préoccupations de la nation et renforcer la mobilisation sociale pour la lutte contre le terrorisme et le recouvrement de l’intégralité du territoire national».
«Notre quotidien est scellé par l’incertitude et l’angoisse du lendemain. L’espoir est difficile sauf à être cynique et de mauvaise foi», a martelé Tiéman Hubert Coulibaly, le président en exil de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD). Cependant, a-t-il préconisé, «face à la logique du chaos et l’incertaine reconstruction, la volonté de survie doit prévaloir et dominer». Et de rappeler, «la quête de paix, de réconciliation et de reconstruction face aux épreuves est un désir ardent des plus nombreux de nos compatriotes». Sans doute nostalgique, comme la plupart des opposants à la transition en exil, Tiéman a souhaité «une année de soulagement pour notre nation afin que chaque Malien se sente mieux dans la chaleur de sa terre natale».
«S’il est clair que le jihadisme et d’autres problèmes sociaux et économiques ont encore une emprise sur notre pays, nous devrions trouver de l’espoir à la fin de cette année…», a rappelé Cheick Boucadry Traoré du parti Convergence africaine pour le renouveau (CARE/Afriki Lakuraya). A son avis, «nos gouvernants et nos dirigeants de la société civile ont aujourd’hui l’opportunité et la possibilité d’être des leaders dans la reconstruction, d’être la promesse de la reprise et des catalyseurs pour réinventer nos communautés».
Quid du retour à l’ordre constitutionnel ?
Au Rassemblement pour le Mali (RPM, ex-parti présidentiel), la «réorganisation structurelle» du parti est plutôt la préoccupation majeure de ses dirigeants. «Nous devons tous nous consacrer, sans exclusive aucune, à la réorganisation structurelle et à la modernisation de notre parti pour l’adapter à la nouvelle carte administrative du Mali et à la mobilisation des ressources intérieures pour le financement des activités du parti à tous les niveaux afin d’assurer une bonne préparation au RPM en vue des futurs rendez-vous politiques», a souligné Dr Bokary Tréta. Le président des «Tisserands» a souhaité que 2024 soit «l’année du RPM» et de la «renaissance de notre Maliba». Dans leurs vœux du nouvel an, les partis ont aussi salué la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa) qui, «malgré les difficultés», ont bravé tous les dangers pour effectuer des pas décisifs dans leur mission de reconquête de notre intégrité territoriale.
Le constat de nombreux observateurs est que peu de partis ou leaders politiques ont ouvertement abordé la très sensible question du rapide retour à l’ordre constitutionnel, notamment à la nécessité d’organiser la présidentielle avant la fin de cette année. Même si Housseini Amion Guindo a souhaité que «cette année soit mise à profit, conformément à nos engagements, pour sortir notre pays de cette période d’exception aux conséquences incalculables sur nos populations». Et de marteler, «aucune malice politique ne saurait éternellement amuser la galerie et détourner le peuple de l’essentiel». Et naturellement que la Codem reste «disponible pour accompagner toutes les initiatives pour un retour à l’ordre constitutionnel».
Comme en 2023, les défis demeurent encore énormes pour cette nouvelle année. Mais, comme l’a si bien rappelé Cheick Boucadry, «le temps est sûrement à l’espoir et à l’optimisme, à la renaissance et au renouveau». Et pour toujours paraphraser le jeune leader politique, «faisons de cette nouvelle année une rampe de lancement pour des améliorations et des changements positifs et durables sur plusieurs fronts… pour nos enfants et petits-enfants» !
Moussa Bolly
Match amical : le Mali en colle 6 à la Guinée-Bissau
Alors que la Tunisie ne trouvait pas la faille face à la Mauritanie, l’autre rencontre disputée dans le même temps ce samedi soir entre le Mali et la Guinée-Bissau offrait, quant à elle, beaucoup plus de spectacle. En effet, les Aigles préparaient parfaitement la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire en giflant les Lycaons avec la manière dans un match prolifique (6-2).
Une victoire impressionnante de la part des hommes d’Eric Chelle, qui voyaient s’illustrer le Brestois Kamory Doumbia, le Salernitain Lassana Coulibaly ou encore le Montpelliérain Falaye Sacko, et ce malgré la réduction adverse du Lyonnais Mama Baldé en première période. De quoi envoyer un véritable message aux Aigles de Carthage, qu’ils affronteront à la CAN dan le groupe E avec la Namibie et l’Afrique du Sud.
L’armée du Mali, de petit dernier à géant d’Afrique de l’Ouest
Le Mali, qui était considéré comme l’un des pays les plus fragiles d’Afrique de l’Ouest, a fait un bond spectaculaire dans le classement des armées les plus puissantes au monde.
Selon le classement de Global Fire Power 2022, le Mali est désormais la troisième meilleure armée d’Afrique de l’Ouest, derrière le Nigeria et le Ghana. Ce classement est un véritable exploit pour le Mali, qui a réalisé ce bond en quelques mois seulement.
Ce succès est notamment dû à la vision et à la détermination du président Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir en 2021. Goïta a rapidement tourné dos à la France, ancienne puissance coloniale du Mali, et s’est tourné vers la Russie. Cette collaboration avec Vladimir Poutine a permis au Mali de recevoir des armes et des formations militaires de la Russie. Les résultats de cette collaboration sont visibles.
L’armée malienne a été modernisée et renforcée, et elle a remporté plusieurs victoires contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans le pays.
SOURCE: 24heureinfo
Le calendrier complet de la phase finale de Groupes de la Coupe d’Afrique de Football CAN 2023
AN 2023. :
![]()
![]() 20h00 : Côte d’Ivoire
20h00 : Côte d’Ivoire![]()
![]()
![]() GuinéeBissau
GuinéeBissau
![]()
![]() 14H00 : Nigéria
14H00 : Nigéria![]()
![]()
![]() GuinéeÉquatoriale
GuinéeÉquatoriale
![]() 17H00 : Egypte
17H00 : Egypte![]()
![]()
![]() Mozambique
Mozambique
![]() 20H00 : Ghana
20H00 : Ghana![]()
![]()
![]() CapVert
CapVert
![]()
![]() 14H00 :Sénégal
14H00 :Sénégal![]()
![]()
![]() Gambie
Gambie
![]() 17H00 : Cameroun
17H00 : Cameroun![]()
![]()
![]() Guinée
Guinée
![]() 20H00 : Algérie
20H00 : Algérie![]()
![]()
![]() Angola
Angola
![]()
![]() 14H00 : Burkina Faso
14H00 : Burkina Faso![]()
![]()
![]() Mauritanie
Mauritanie
![]() 17H00 : Tunisie
17H00 : Tunisie![]()
![]()
![]() Namibie
Namibie
![]() 20H00 : Mali
20H00 : Mali![]()
![]()
![]() Afrique du Sud
Afrique du Sud
![]()
![]() 17H00 : Maroc
17H00 : Maroc![]()
![]()
![]() Tanzanie
Tanzanie
![]() 20H00 : RD Congo
20H00 : RD Congo![]()
![]()
![]() Zambie
Zambie
![]()
![]() 14H00 :GuinéeEquat
14H00 :GuinéeEquat![]()
![]()
![]() GuinéeBissau
GuinéeBissau
![]() 17H00 : Côte d’Ivoire
17H00 : Côte d’Ivoire![]()
![]()
![]() Nigéria
Nigéria
![]() 20H00 : Egypte
20H00 : Egypte![]()
![]()
![]() Ghana
Ghana
![]()
![]() 14H00 : CapVert
14H00 : CapVert![]()
![]()
![]() Mozambique
Mozambique
![]() 17H00 : Sénégal
17H00 : Sénégal![]()
![]()
![]() Cameroun
Cameroun
![]() 20H00 : Guinée
20H00 : Guinée![]()
![]()
![]() Gambie
Gambie
![]()
![]() 14H00 : Algérie
14H00 : Algérie![]()
![]()
![]() Burkina Faso
Burkina Faso
![]() 17H00 : Mauritanie
17H00 : Mauritanie ![]()
![]()
![]() Angola
Angola
![]() 20H00 : Tunisie
20H00 : Tunisie![]()
![]()
![]() Mali
Mali
![]()
![]() 14H00 : Maroc
14H00 : Maroc![]()
![]()
![]() RD Congo
RD Congo
![]() 17H00 : Zambie
17H00 : Zambie![]()
![]()
![]() Tanzanie
Tanzanie
![]()
![]() 17H00 : Guinée Éq
17H00 : Guinée Éq![]()
![]()
![]() Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
![]() 17H00 : GuinéeBissau
17H00 : GuinéeBissau![]()
![]()
![]() Nigéria
Nigéria
![]() 20H00 : Mozambique
20H00 : Mozambique![]()
![]()
![]() Ghana
Ghana
![]() 20H00 : Cap-Vert
20H00 : Cap-Vert![]()
![]()
![]() Egypte
Egypte
![]()
![]() 17H00 : Guinée
17H00 : Guinée![]()
![]()
![]() Sénégal
Sénégal
![]() 17H00 : Gambie
17H00 : Gambie![]()
![]()
![]() Cameroun
Cameroun
![]() 20H00 : Angola
20H00 : Angola![]()
![]()
![]() Burkina Faso
Burkina Faso
![]() 20H00 : Mauritanie
20H00 : Mauritanie![]()
![]()
![]() Algérie
Algérie
![]()
![]() 17H00 : Afrique du Sud
17H00 : Afrique du Sud ![]()
![]()
![]() Tunisie
Tunisie
![]() 17H00 : Namibie
17H00 : Namibie![]()
![]()
![]() Mali
Mali
![]() 20H00 : Tanzanie
20H00 : Tanzanie![]()
![]()
![]() RD Congo
RD Congo
![]() 20H00 : Zambie
20H00 : Zambie![]()
![]()
![]() Maroc
Maroc


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.